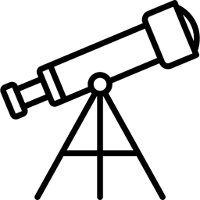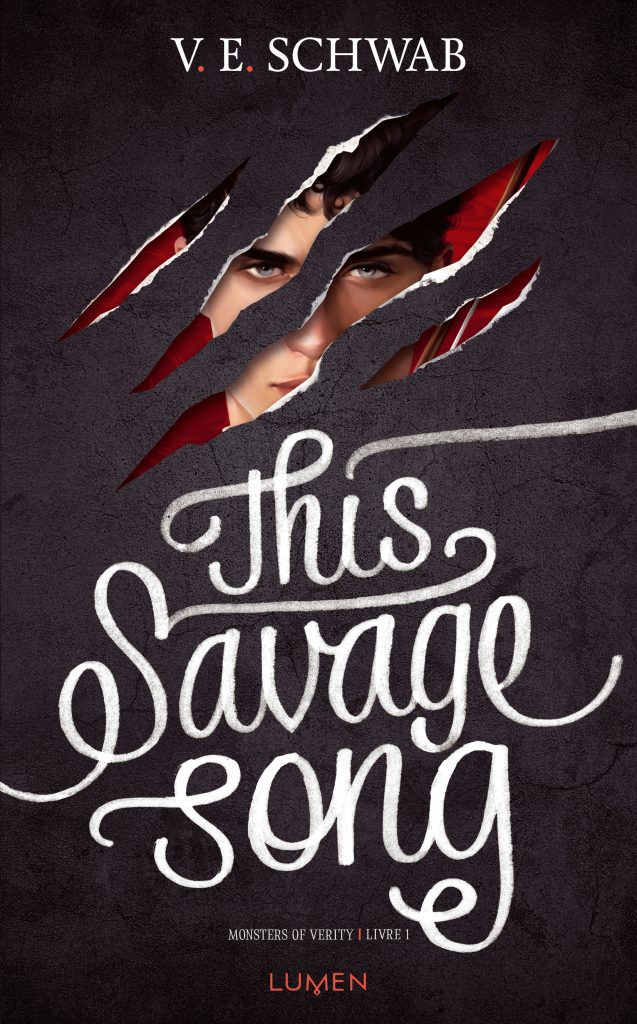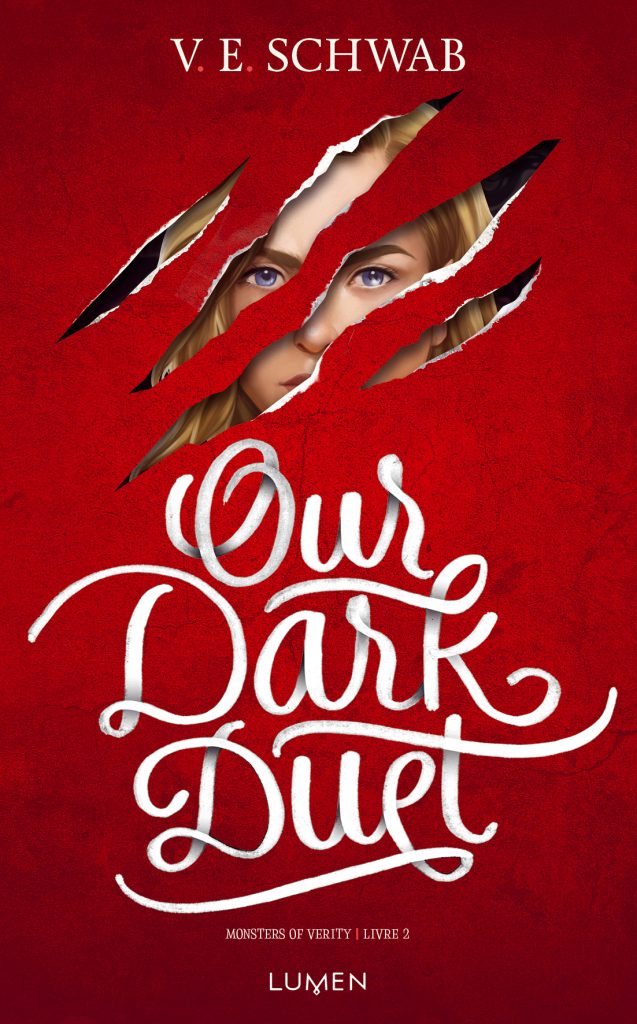La dark romance s’impose depuis quelques années comme l’un des genres les plus lus — et les plus débattus — parmi les jeunes lecteurs et lectrices. Popularisée par des autrices comme Penelope Douglas, L.J. Shen ou, plus récemment, Sarah Rivens en France, elle mêle passions sombres, dynamiques toxiques et récits de reconstruction psychologique. Si le genre séduit un lectorat avide d’émotions fortes, il soulève aussi des critiques : romantisation de la violence, confusion des repères, saturation de trigger warnings…
Dans cet entretien, Océane Ghanem et Jenn Guerrieri, autrices emblématiques issues de la plateforme Wattpad et aujourd’hui publiées dans les plus grandes maisons d’édition de romance contemporaine, comme Plumes du Web, reviennent sur leur parcours, leur vision de la littérature sentimentale et les enjeux de l’écriture cathartique. À travers leurs réponses, elles interrogent aussi la réception genrée de la romance, la place de la santé mentale dans leur métier, et les frontières floues entre fiction et société.
À la croisée de la littérature populaire et de l’intime, les œuvres d’Océane Ghanem et de Jenn Guerrieri participent du renouveau contemporain de la romance, en particulier dans sa déclinaison dite « dark ». Revenant sur leurs parcours d’autrices, leurs choix esthétiques et les controverses suscitées par le genre, elles interrogent les fonctions cathartiques et sociales de l’écriture romanesque, tout en mettant en lumière les enjeux professionnels et psychiques de leur activité.
Emeline de Chevron Villette : Pourquoi avez-vous choisi d’écrire de la romance ?
Océane Ghanem : À l’origine, je suis une passionnée de fantasy, et en particulier de bit-lit[1] : j’ai beaucoup lu Nalini Singh, Patricia Briggs, Karen M. Moning… Mes premières affinités littéraires allaient vers ces livres aux plumes soignées et aux univers riches. Ce sont d’ailleurs ces imaginaires qui ont porté mes premiers écrits. Je me suis peu à peu tournée vers la romance parce que c’est ce que je préférais écrire : je parvenais mieux à m’identifier à mes personnages, à développer mes idées avec authenticité. Concernant mes sources d’inspiration, ce sont avant tout certaines thématiques qui me touchent : lorsqu’un sujet m’émeut, je l’explore dans un récit, c’est un moyen pour moi de mieux me comprendre et de reprendre la main sur certains aspects de ma propre vie.
Jenn Guerrieri : Je suis pour ma part une lectrice assidue de romances, en particulier de romances sombres, psychologiques. Je suis entrée dans cet univers notamment avec L.J. Shen et Pénélope Douglas. Cette passion m’a ensuite naturellement donné envie d’écrire et, lorsque je me suis lancée, j’ai découvert à quel point c’était thérapeutique pour moi. Je suis particulièrement inspirée par les univers artistiques, comme la danse, la musique, la peinture, etc.
Lamia Gormit : Qu’est-ce qui fait une bonne romance selon vous ?
JG : En tant qu’autrice, il me semble essentiel de diversifier les thématiques que j’aborde pour exprimer ma créativité. J’aime sortir de ma zone de confort, mes histoires sont très différentes les unes des autres. Du reste, cela dépend aussi des attentes du lecteur : certains ont besoin de s’évader, de se divertir, d’autres sont plus sensibles à la qualité du style ou aux personnages.
OG : Je considère qu’une bonne romance, c’est avant tout une belle plume. J’ai une préférence pour les plumes soignées, poétiques, capables de transmettre des émotions profondes. Dans une dark romance, je pense que la psychologie des personnages est primordiale : lorsque l’on aborde des thématiques sombres, voire dérangeantes, il faut maîtriser ses personnages, qu’ils soient crédibles et nuancés.
LG : De nombreuses romances francophones se déroulent aux États-Unis. Est-ce un attendu du genre ?
JG : Quand nous avons commencé à écrire, aux alentours de 2017, les romances se situaient effectivement souvent aux États-Unis, un pays qui suscitait beaucoup de fascination à l’époque. À mon sens, une histoire campée dans un pays étranger permet au lectorat de s’évader, de voyager. Aujourd’hui, je trouve que les décors sont de plus en plus variés. On voit émerger des histoires ancrées en Europe, au Royaume-Uni ou au Brésil, je pense notamment au roman de Marine M.L., Le Serpent et la Mule. Avec Océane, nous avons aussi coécrit un roman dans un décor parisien, L’Art du trompe-l’œil, où l’on aborde les beaux-arts.
OG : À mon avis, si l’on écrit une romance qui se déroule dans un environnement familier, nous avons tendance à y projeter des éléments de notre quotidien, voire des convictions personnelles ou politiques. Or, ce sont des choses que les lecteurs ne recherchent pas forcément dans une œuvre destinée à divertir. Le choix d’un cadre étranger nous permet donc une plus grande liberté narrative : une société que l’on connaît moins a une influence moindre sur notre écriture, ouvrant davantage de possibilités créatives. Lorsque nos lectrices françaises ont lu L’Art du trompe-l’œil, par exemple, elles n’ont sûrement pas reconnu le Paris dans lequel elles évoluent au quotidien. C’est un Paris romanesque, idéalisé, en décalage avec ce tout qu’elles connaissent !
LG : L’écriture de dark romance est-elle pour vous une forme de catharsis ?
JG : Oui, tout à fait. Dans mon dernier livre, Blue Savior, une dark romance centrée sur la dépression, je me suis directement inspirée de mon propre vécu. L’écriture m’a permis de mieux comprendre ce que je traversais, de mettre des mots sur cet état que j’avais moi-même connu. Dans L’Art du trompe-l’œil, nous avons aussi abordé avec Océane le cyberharcèlement parce qu’on l’a toutes les deux vécu. Écrire à ce sujet relevait autant, je crois, du besoin de témoigner que de celui de guérir. L’écriture est plus qu’un moyen d’expression pour moi, c’est un exutoire, voire une thérapie.
LG : Les détracteurs de la dark romance lui reprochent de romantiser des violences extrêmes. Que leur répondez-vous ?
OG : Ces violences renvoient à une réalité sociale, celle d’une société encore très violente à l’égard des femmes. On ne peut pas reprocher aux autrices d’écrire sur ce qu’elles connaissent et subissent au quotidien. Il me semble qu’aborder les violences sexistes et sexuelles dans les dark romances est effectivement une forme de réappropriation, une manière de traiter un fait de société en montrant qu’il est souvent possible de s’en relever et de dépasser un statut de victime. J’exclus de mon propos les livres qui idéalisent ou banalisent le viol : ces thématiques doivent être traitées avec sérieux et de manière respectueuse.
JG : Oui, et le genre a beaucoup évolué. Aujourd’hui, les dark romances mettent en lumière de plus en plus de figures féminines fortes, comme le personnage de King qu’a écrit Océane dans Les Oiseaux de la liberté, ou mon personnage dans L’Aube écarlate, une femme déterminée, loyale et dévouée à sa famille, qui se bat. Par ailleurs, concernant les détracteurs, la romantasy est quasiment épargnée par les critiques, alors qu’on y trouve des thématiques similaires à la dark romance : personnages maltraités, traumatismes, violence… Je pense que les détracteurs de la dark romance la connaissent finalement assez peu ; à mon sens, il faut éviter les généralisations relatives au genre, et évoquer plutôt les livres en eux-mêmes.
EdCV : Que pensez-vous des trigger warnings ?
JG : Lorsque j’ai publié ma première romance, en 2019, les trigger warnings n’étaient pas vraiment pris en compte. Aujourd’hui, nous veillons à inclure en début d’ouvrage une liste d’avertissements sur les thématiques sensibles abordées, parfois accompagnée d’un mot de l’auteur ou de l’autrice afin de contextualiser et de prévenir le lectorat. Je crois que le succès de la dark romance a pris tout le monde de court, notamment après le phénomène Captive, de Sarah Rivens. Il est donc essentiel, selon moi, de poursuivre ce travail de mise en garde, et de mieux informer les libraires et l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre et de la médiation. On voit encore trop de jeunes adolescents avec des livres qui devraient être réservés à un public majeur.
OG : À mon sens, il faut également redéfinir et insister sur les différentes branches de la romance : le new adult[2] n’est pas du young adult[3], le premier implique des scènes de smut[4] destinées à un public adulte et averti. De plus, les couvertures de new adult font parfois penser à du young adult, le milieu éditorial jouant avec cette limite floue entre les deux. Ce ne sont pas les jeunes eux-mêmes qui verront le problème avec des scènes particulièrement graphiques ou explicites dans certains livres, il faut que l’on puisse les conseiller correctement.
LG : Selon vous, à quel public vos œuvres s’adressent-elles ?
OG : Cela dépend des livres. Meri Jaan, par exemple, ne me semble pas adapté à un public de moins de 18 ans. Le roman contient de nombreuses scènes explicites et aborde frontalement la question de la sexualité féminine, qui peut être mal comprise ou mal interprétée sans une certaine expérience et maturité. À l’inverse, Losers’ Fraternity, coécrit avec Jenn, porte des messages positifs et peut, selon moi, être lu dès 15 ans.
JG : Je situe mon cœur de cible entre 16 et 25 ans, même si, en salon, nous rencontrons aussi des lecteurs et lectrices beaucoup plus jeunes ou plus âgés. Il me semble que cela dépend aussi en grande partie de la maturité de chacun. Je conseillerais par exemple Tainted Hearts à partir de 16 ans, tout en soulignant l’importance de bien prendre connaissance des trigger warnings. Le roman aborde le thème de la reconstruction après un viol, avec notamment une scène explicite présentée sous forme de flashback dans le deuxième tome. Par ailleurs, la relation entre les deux protagonistes est toxique, haineuse, ce qui nécessite un certain recul : les jeunes lectrices doivent être en mesure de distinguer clairement la réalité de la fiction.
EdCV : Pensez-vous que les romances sont aussi souvent décriées car écrites majoritairement par des femmes ?
OG : Oui, il existe encore beaucoup de misogynie, même chez certains professionnels du livre comme les commerciaux ou les libraires – j’en ai moi-même fait l’expérience. La romance souffre aussi souvent d’une forme de mépris, sans doute parce qu’elle est accessible, alors que c’est cette accessibilité qui lui permet de toucher un très large public en abordant des thématiques universelles. C’est de plus un genre qui évolue avec son temps : notre conscience collective s’affirme, nos engagements sont plus visibles et les réseaux sociaux peuvent porter notre voix. Ce genre a toujours été un espace d’expression et de prise de position, mais aujourd’hui je trouve qu’il est plus assumé. Les nouvelles générations sont plus conscientes de ce qu’elles lisent et revendiquent ce qu’elles ont envie de lire.
JG : J’ai été pour ma part assez épargnée par les remarques sexistes concernant mes livres mais je sais que ce type de commentaires reste fréquent. La romance a longtemps souffert de cette réputation injuste, reléguée au « roman de gare ». Aujourd’hui, elle a en effet beaucoup évolué, on y aborde des sujets de société importants comme la santé mentale, le harcèlement scolaire, la diversité, etc. Des thématiques qui résonnent particulièrement auprès des jeunes. C’est un genre qui offre un espace d’évasion mais qui est aussi un moyen de s’identifier, de se sentir écouté. Aujourd’hui, l’aspect communautaire autour de la romance est très fort et porté par les réseaux : il y a de plus en plus de clubs de lecture 100 % romance, de salons 100 % romance, d’influenceurs, etc.
LG : Y-a-t-il des questions que vous aimeriez qu’on vous pose en tant qu’écrivaines ?
JG : La question de la santé mentale des auteurs et autrices ! Dans notre entourage, beaucoup ignorent les phases sombres que l’on peut traverser. C’est un privilège de vivre de sa passion mais, en coulisses, certaines réalités sont vraiment difficiles. Ce qui me pèse le plus, c’est la précarité de ce métier : la source de revenu est instable, elle ne permet aucune projection à long terme. C’est une dimension ignorée du milieu, qui concerne aussi celles et ceux qui ont énormément de succès.
OG : La pression est aussi très difficile : une phrase mal formulée peut tout faire basculer, la peur de décevoir les lectrices est constante. À cela s’ajoutent effectivement la précarité, l’isolement face à l’écran. La cadence est particulièrement exigeante en romance, c’est l’un des seuls genres où l’on attend autant de publications de la part des auteurs. Nos éditrices nous soutiennent, mais les échanges restent avant tout professionnels. Nous avançons dans la tempête en essayant de préserver notre santé mentale, alors même que nous sommes les moins rémunérées. C’est un équilibre précaire, assez anxiogène.
Propos recueillis et mis en forme par Lamia Gormit, rédactrice en chef de la revue Lecture Jeune, et Emeline de Chevron Villette, assistante de la rédaction
Entretien avec Océane Ghanem et Jenn Guerrieri, autrices de romances sombres, publié préalablement dans Lecture Jeune
Découvrez d’autres entretiens et articles de spécialistes dans le numéro spécial romance et dark romance de Lecture Jeune.
N’hésitez pas à vous former sur la question en vous inscrivant au parcours « 50 nuances de romances : de la comédie romantique à la dark romance, appréhender la romance et son public »
[1] Sous-genre littéraire de fantasy urbaine qui met en scène des vampires, des monstres et des créatures surnaturelles
[2] Terme créé pour le différencier du young adult, parce que concernant des livres s’adressant à un public plus âgé et plus averti
[3] Catégorie éditoriale se référant aux livres destinés à un public entre 12 et 18 ans
[4] Scènes érotiques explicites